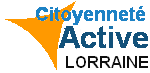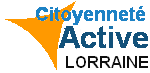| « Les sociétés occidentales doivent retrouver foi dans le progrès » | 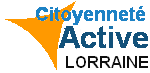
|
LE MONDE ECONOMIE 20.10.2016
Par Philippe Moati (Professeur d’économie à l’université Paris-Diderot et cofondateur de l’Observatoire société et consommation)
«
Les résultats de l’étude de la Commission européenne confirment la
présence d’une aspiration à combler les impensés de la modernité en
renouant le lien avec la nature et avec une vision plus complète d’un
homme en quête de relations interpersonnelles ».
Par Philippe Moati (Professeur d’économie à l’université Paris-Diderot et cofondateur de l’Observatoire société et consommation)
La
campagne pour la présidentielle est bien mal engagée. Manœuvres
politiciennes et prises de position péremptoires allant dans le sens du
poil d’une opinion versatile se disputent le devant de la scène
médiatique. On peine à voir poindre un véritable projet, une
perspective qui témoignerait d’une compréhension des enjeux de notre
époque et de l’urgence d’une refondation de l’action politique.
Les
sociétés occidentales sont malades d’avoir perdu la boussole du
progrès. La modernité dont elles sont issues est en crise, en
particulier cette foi dans la raison qui devait produire le progrès
social. Dans le temps long, la promesse a été tenue. Malheureusement,
le ressort semble s’être cassé.
Si
la science et la technologie progressent encore à grands pas, si
l’économie continue bon an mal an de croître, ce progrès ne semble plus
au service de l’intérêt collectif. Crise environnementale, montée des
inégalités, instabilité financière… le progrès est devenu difficile à
percevoir pour le commun des Occidentaux.
Malaise existentiel
Le
doute s’installe et le pessimisme gagne. Selon l’Eurobaromètre de la
Commission européenne, moins d’un quart des ressortissants de l’Union
anticipent que la vie des enfants d’aujourd’hui sera plus facile que
pour ceux de leur génération ; 50 % pensent même qu’elle sera plus
difficile (dont 67 % des Français). Nous n’avons collectivement plus
confiance dans la matrice dont nous sommes issus ; comment espérer
continuer d’être un modèle pour le monde si notre propre avenir ne nous
semble pas désirable ?
Alors
que les valeurs fondamentales de la culture occidentale se trouvent
contestées, il est urgent de renouer avec une vision positive de notre
avenir, faute de quoi nous vivrons cette confrontation des systèmes de
valeurs en position de faiblesse, offrant une perméabilité à des
visions du monde susceptibles de remettre en cause les acquis de la
modernité qui soutiennent encore l’édifice.
Car
comment ne pas voir dans le retour du religieux, du régionalisme, du
nationalisme, du populisme, voire dans l’écologisme radical, les effets
d’un malaise existentiel résultant d’une difficulté à se situer et à se
définir dans un monde devenu indéchiffrable, incertain et perçu comme
dangereux ?
Concevoir un projet collectif
Il
nous faut donc relancer le projet moderne, celui d’une dynamique dans
laquelle la communauté des hommes œuvre pour le bien commun, pour le
progrès des conditions de vie matérielles, sociales, culturelles,
spirituelles. Pour cela, nous devons renouer avec une forme d’utopie
qui dessine un horizon désirable partagé, apte à répondre à la quête de
sens d’une population au stade de l’opulence mais que la logique
consumériste ne suffit plus à satisfaire.
Force
est de reconnaître que le magasin des utopies est plutôt mal achalandé.
On peut cependant en repérer trois grandes qui, aujourd’hui,
s’expriment au travers de relais d’opinion, et de mouvements plus ou
moins organisés : la décroissance, la société collaborative ou
participative, ainsi que le transhumanisme. L’une ou l’autre de ces
utopies est-elle en mesure d’emporter une adhésion suffisamment large
pour constituer un embryon de projet collectif ?
NOUS DEVONS RENOUER AVEC UNE FORME D’UTOPIE APTE À RÉPONDRE À LA QUÊTE DE SENS
L’Observatoire
société et consommation les a soumises à un échantillon représentatif
de Français, mais aussi d’Allemands, d’Italiens et d’Espagnols.
Présentées comme des états que la société pourrait atteindre dans dix
ou vingt ans, elles ont été décrites en quelques lignes – en veillant à
l’équilibre entre les bénéfices individuels et collectifs et les
contreparties négatives. Puis chaque répondant a été invité à donner
une note de 0 à 10 exprimant son degré d’adhésion aux scénarios
proposés et, finalement, à désigner l’utopie la plus proche de sa
société idéale.
C’est
la décroissance qui arrive en tête. A l’échelle des quatre pays
étudiés, elle est choisie par 47 % des personnes interrogées, et c’est
en France qu’elle recueille le plus de suffrages (51 %). Vient ensuite
l’utopie collaborative ou participative (36 %, dont 33 % en France),
alors que le transhumanisme est à la traîne, avec seulement 17 % (16 %
en France).
Combiner les utopies
Que
déduire de ces résultats ? Tout d’abord, qu’ils confirment la présence
d’une aspiration à combler les impensés de la modernité en renouant le
lien avec la nature et avec une vision plus complète d’un homme en
quête de relations interpersonnelles. Ensuite, qu’aucune de ces trois
utopies ne réussit à créer un large consensus. Cela transparaît dans
les notes moyennes (respectivement 6,9, puis 6,3 et 5,5 à l’échelle des
quatre pays), qui témoignent d’un enthousiasme au mieux modéré.
Il
y a probablement matière à combiner ces utopies, à tenter de prendre
ce que chacune a de meilleur pour en tirer un projet de société
susceptible de mobiliser sur une base élargie. De la décroissance,
reprendre la priorité à donner à la sauvegarde de la planète,
l’aspiration au ralentissement ; du participatif, la revitalisation du
lien social, la remise en cause des structures verticales et le projet
de donner à chacun les moyens d’être acteur de sa vie et de la cité ;
du transhumanisme, la foi dans un progrès technique maîtrisé pour
améliorer la qualité de la vie et faire face au défi écologique.
On
voit ainsi la possibilité d’une refondation du projet moderne autour
de la transition vers un nouveau modèle de développement. Si beaucoup
reste à préciser, on a peut-être là une boussole indiquant le cap
redonnant confiance dans le sens du changement. Alors que la campagne
pour la présidentielle risque d’osciller entre des considérations
gestionnaires et des incantations autour du thème de l’identité, il y a
là un terrain fertile de renouvellement du discours et de l’action
politiques.
Philippe Moati est l’auteur de « La Société malade de l’hyperconsommation » (Odile Jacob, 256 p., 22,90 euros).